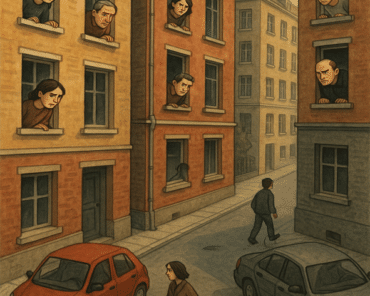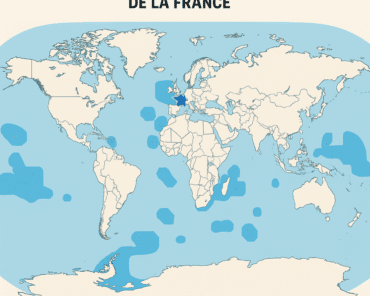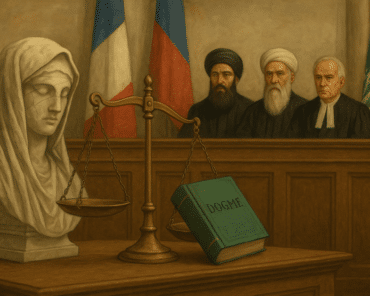Depuis hier les médias expliquent que la consommation en France de cocaïne a explosé avec plus d’un million de consommateurs réguliers, venant en quelque sorte confirmer les informations quant au développement inquiétant du narcotrafic dans de nombreuses villes et campagnes avec, dans certains cas, son cortège de violence et de meurtres et de victimes collatérales…

Photo :
Il est parfois des moments où le rapprochement de deux informations a un effet perturbant
Registre : drogue, stupéfiants, trafic, violence