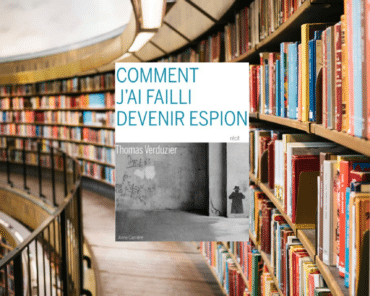Les relations entre la France et l’Algérie connaissent de fortes fluctuations, si bien que l’accord franco-algérien, permettant des facilités d’échanges entre les deux pays, est l’objet de vives critiques de la part de responsables français. Faut-il dénoncer l’accord de 1968 ? Ou seulement ses formats révisés ultérieurement ? Rym Boukhari-Saou, avocate franco-algérienne nous répond.

Photo :
Faut-il revoir l’accord franco-algérien de 1968 ?
Registre : Accords de 1968, Algerie, immigration, OQTF